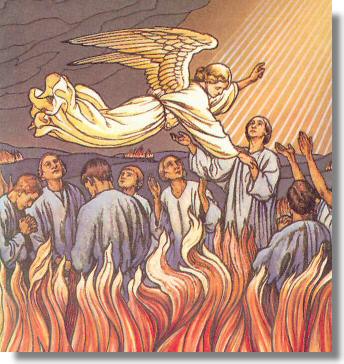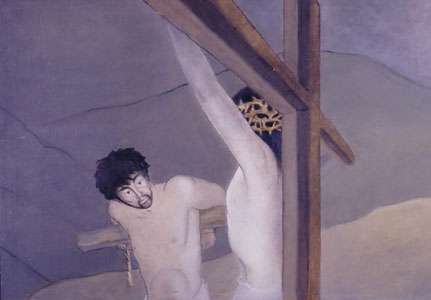Le Purgatoire
Paul-Victor Desarbres
Doctrine formulée aux Conciles de Florence et de Trente, le purgatoire ou purification finale fait parfois figure d'objet de curiosité dans l'arsenal théologique contemporain. L'on se voit, de fait, rapidement contraint à poser des questions en termes abrupts: l'idée d'une purification nécessaire post-mortem appartient-elle à un âge d'obscurantisme révolu? N'est-elle que l'expression d'une piété doloriste, marquée par la distance vis-à-vis de celui qui annonce que le royaume de Dieu est « parmi vous »1, qui ne « condamne pas » la femme adultère 2 et surtout qui répond au larron lequel lui demande de se souvenir de lui quand il sera entré dans son Royaume: « Amen, je te le dis, c'est aujourd'hui que tu seras avec moi dans le Paradis »?
Pour tenter de répondre à ces questions, il convient de redécouvrir la profonde réalité spirituelle, et donc la vérité évangélique que recèle ce terme. Sans doute faut-il y voir tout d'abord une réponse à la faiblesse spirituelle dont nous pouvons faire preuve. L'on a beau se (faire) relever des fautes que l'on commet, celles-ci ne restent pas toujours sans conséquences sur notre vie. Si le pardon de nos fautes nous réconcilie avec Dieu, nous ne sommes pas toujours tout à fait détachés d'elles. Autrement dit, le pardon n'est pas une fin, il est un commencement; c'est lorsque nous sommes pardonnés que nous pouvons chercher à réparer nos fautes, leurs conséquences sur les autres et sur nous-mêmes; c'est lorsque nous sommes pardonnés que tout devient possible (ce qui explique que le sacrement de réconciliation n'est pas seulement un « simple » soulagement, mais aussi une tâche à accomplir, dont Dieu rend capable). On le voit, il peut toujours y avoir un hiatus entre la miséricorde parfaite de Dieu et notre réceptivité bien imparfaite, entre la grâce par laquelle il veut nous amener à lui et la pesanteur de nos vies.
Une représentation traditionnelle du purgatoire.
Il ne s'agit pas de remettre en cause le pardon qui vient de Dieu, mais de reconnaître que certaines de nos conversions ne s'opèrent pas en un clin d'oeil. On voit bien qu'il faut parfois du temps. Pour simplifier: on peut bien comprendre que la sainteté de Thérèse de Lisieux, son abandon au Christ la rende déjà prête à voir Dieu; en dirait-on autant d'un criminel de guerre? Il faut parfois apprendre à rapetisser, à entrer dans la joie éternelle de la Béatitude, prendre le temps d'entrer dans l'éternité, sans doute est-ce l'intuition, le paradoxe même que développe la doctrine du purgatoire. Mettre à mort le vieillard en nous, laisser la place à l'homme nouveau qui, lui, ne passe pas et participe de l'éternité divine: toutes ces tâches de notre vie, la joie de l'Évangile nous invite à penser qu'elles se prolongent au-delà de la vie, que le Christ ne s'adresse pas aux parfaits mais aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes de bonne volonté.
Il y a donc une formidable espérance à se dire que l'union parfaite avec Dieu, si personne d'entre nous ne peut la réaliser, Dieu la réalisera, à la mesure des capacités de chacun, même si l'on « avai[t] commis tous les crimes possibles » (sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face). Le purgatoire n'est pas une invention de théologiens médiévaux aigris souhaitant réglementer l'accès à la plate-forme « paradis », il est un état d'espérance qui mène de façon certaine à la béatitude en Dieu 3. Ce n'est pas une mesure divine de restriction des effectifs par sélection sur dossier ou concours, c'est une façon de nommer l'extension de l'espérance du royaume promise par le Christ, la sollicitude toujours plus grande de Dieu pour les pécheurs. Le purgatoire est ainsi, plus qu'un état de sortie du temps, un état d'entrée certaine dans l'éternité bienheureuse.
L'exemple du bon larron donne à réfléchir en ce sens; cet épisode qui est rapporté dans saint Luc pose sans doute de façon plus claire la problématique purgatoire. Jésus est en effet en croix avec deux autres hommes, des malfaiteurs, semble-t-il. Il est à un moment où ses paroles sont comptées, car le crucifié meurt par asphyxie. Les mots qu'il prononce sont ceux qu'il juge d'une importance capitale.
« L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait: “ N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi! ” Mais l'autre le reprit en disant: “ Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine! Pour nous, c'est juste: nous recevons ce que nos actes ont mérité; mais lui n'a rien fait de mal. ” Et il disait: “ Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume.” Jésus lui répondit: “ En vérité, je te le dis, c'est aujourd'hui que tu seras avec moi dans le Paradis.”» 4
Celui que la tradition nomme le bon larron n'est certes pas le pire des hommes, mais sans doute faut-il rappeler que le récit évangélique nous le présente presque aussi obséquieux que son acolyte est révolté. Aussi belles que ses paroles puissent être, aussi lucides soient-elles, elles ne sont pas tout à fait exemptes d'égoïsme: il fait la leçon au second larron devant Jésus, comme pour faire plonger son petit camarade, il se préoccupe avant tout de lui-même (« souviens-toi de moi »). Mais il dit une parole capitale à Jésus, à savoir que celui-ci va être dans son royaume, donc que tout ne finit pas sur la croix, que la croix ne signifie pas sa disparition, qu'il y a autre chose, bref, il fait acte de foi. La réponse de Jésus ne tarde pas et mérite d'être regardée à la loupe. L'évangile de saint Luc est d'une langue très étudiée, et la proximité entre un futur (qui peut aussi rendre un futur proche) et l'adverbe «aujourd'hui» (qui peut aussi signifier maintenant, désormais) doit faire l'objet d'attention: Jésus, par cette formule qui semble désigner un temps proche et présent, fait sortir le larron de l'instant du supplice, il lui donne une promesse, il le choisit personnellement, non pas pour ses mérites, mais parce qu'il s'est tourné vers lui. Il le fait entrer dans le toujours-déjà de sa résurrection qu'il anticipe (car elle doit advenir le troisième jour). Il le prend avec lui, mais on comprend bien que ce n'est pas une fin, que précisément, il n'en a pas fait un homme parfait, mais qu'il le prend en charge car il s'en est remis à lui. On peut penser que face à la mort, cet évangile présente un renversement de la fin, qu'il envisage un avenir au moment du terme, que la rencontre avec le Christ peut s'approfondir, même quand la mort vient surprendre; c'est ce que l'on peut nommer l'ouverture à l'espérance de la purification — le purgatoire. Voilà l'idée qu'exprime cet évangile, comme un contrepoint à ce que pourraient avoir de dur les paroles du Christ sur l'attente du Maître 5. Comme si le bon larron s'était « réveillé » au tout dernier moment, dans une étincelle de lucidité qui va racheter toute sa vie.
Le bon larron.
Le purgatoire a de quoi en effrayer plus d'un, et pourtant, il n'est pas — loin s'en faut — réductible à un décret figé, à un oukase arbitraire d'une Église d'une autre époque, mais un dogme par excellence, c'est-à-dire, pour reprendre les mots du Cardinal Ratzinger, « une fenêtre ouverte sur le ciel » auquel Dieu cherche à mener l'homme, et, par là, un outil sur lequel s'appuyer pour la compréhension du mystère de la bonté divine qui seule compte.
P.-V. D.
Index du numéro.
 Aumônerie catholique
Aumônerie catholique