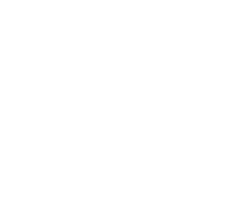
Les Talas de l'École Normale Supérieure
Riche d’une histoire qui remonte aux origines de l’École et héritier de traditions séculaires, le groupe tala fait partie des associations les plus actives de l’ENS. De nombreuses archives et documents témoignent de cette longue histoire dont voici les grandes lignes en quelques mots.
« Tala » : c’est par ce nom assez mystérieux qu’est désigné depuis la fin du XIXème siècle le groupe des étudiants catholiques de l’ENS. L’étymologie est incertaine et débattue. Il est cependant moins vraisemblable qu’elle soit issue de « ceux qui vont-t-à-la messe » que du mot « talapoin », cité par Voltaire dans le Traité sur la Tolérance, qui évoque l’équivalent du prêtre chez les Bouddhistes et qui renvoie au siècle suivant à une dévotion extrême et exotique. Si le nom « tala » surgit probablement dans les années 1880 dans la bouche d’étudiants railleurs, ce qui est sûr, c’est qu’il est fermement établi pour désigner, de façon humoristique, les catholiques de l’ENS au moment du centenaire de l’École en 1895.
Depuis sa fondation et jusqu’en 1881, l’École est dotée d’une aumônerie officielle, avec un aumônier nommé par le ministère de l’Instruction Publique et une chapelle (dont la porte existe toujours, là où se situe le département de Littératures et de Langage). Cependant, déjà à ce moment-là, certains catholiques se retrouvent en dehors de ce cadre et des obligations religieuses du règlement, mus par un désir de formation spirituelle plus approfondie et de charité plus active – c’est en cela que l’on peut voir les prémices du groupe tala, bien qu’il n’en porte pas encore le nom.
En effet, dès le début du XIXème siècle, les normaliens catholiques se sont largement engagés dans les Conférences Saint-Vincent-de-Paul, fondées quelques années auparavant par un jeune professeur de la Sorbonne, Frédéric Ozanam, et se sont attachés à l’exercice concret de la charité envers les plus nécessiteux à Paris et tout spécialement dans le Vème arrondissement où – à l’époque – la misère est une réalité commune. Quelques récits de normaliens témoignent de ce fort engagement, comme par exemple celui d’Henri Hignard, qui deviendra professeur de lettres classiques à la faculté de Lyon et qui écrit à propos de sa première journée à l’École en 1938 : « j’ai été très bien accueilli par quelques jeunes gens des années précédentes qui ont vu en moi un catholique. Tous sont de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et c’est une raison de plus pour me lier avec eux ». Ce désir de servir les plus pauvres conduit ce petit groupe de normalien à fonder avec Sœur Rosalie Rendu en juin 1839 la deuxième conférence de ce réseau de charité au milieu des paroisses Saint-Médard et Saint-Marcel. Dans les décennies qui ont suivi, plus de 200 étudiants de l’ENS s’y sont investis, afin d’unir à l’apostolat de l’enseignement celui de la charité, dans ce que l’on a appelé son « école d’application ».
Signe de contradiction au cœur d’une école qui se voulait avant tout être un « séminaire laïc », ces « proto-talas » se retrouvent régulièrement à devoir justifier leurs positions religieuses sur le plan de la raison, ce qui les encourage à approfondir « l’intelligence de la foi ». C’est notamment sous l’impulsion de l’abbé Alphonse Gratry, aumônier de l’Ecole entre 1846 et 1851 et grande figure du catholicisme libéral du XIXème siècle, que cette exigence intellectuelle se développe et qu’émerge un petit groupe d’étudiants à qui apparait de façon prégnante « ce qu’il y aurait de fécond pour le développement de la science chrétienne dans une association libre d’hommes habitués aux recherches de l’érudition » (Mgr Perraud, cité dans le recueil des souvenirs de jeunesse du P. Gratry). Les premiers « jeudis talas » trouvent ici leur origine : l’abbé Gratry recevait en effet les normaliens catholiques le jeudi soir dans sa chambre du palais du Luxembourg (il était aussi aumônier de la Chambre des Pairs en même temps) où il leur fournissait quelques armes pour les controverses religieuses auxquelles ils étaient confrontés à l’ENS.
L’année 1881 marque la fin de l’aumônerie officielle de l’Ecole et donc la destruction de la chapelle, provoquant des « discussions passionnées » : paradoxalement, il semble que cela a plutôt conduit à vivifier le bastion catholique à l’ENS, avec l’émergence d’une génération davantage « militante ». Cependant, au tournant du siècle, les premiers talas proprement dits sont confrontés à de nombreuses batailles sur le plan politique (expulsion des congrégations, débats sur la loi de 1905, etc.) et intellectuel (polémiques universitaires sur le positivisme, crise moderniste) et voient leurs effectifs un peu affaiblis pendant quelques années. Emergeront néanmoins de grandes figures universitaires, tels Pierre Duhem (physicien) ou Maurice Blondel (philosophe) qui proposeront une alternative aux courants intellectuels majoritaires.
Au fur et à mesure du temps, chacune des « institutions » talas se constitue et devient tradition. Au début du XXème siècle, le groupe se rassemble le lundi soir pour des conférences et le jeudi soir pour la messe, avec un aumônier devenu officieux, le père Portal, un lazariste, pionnier du dialogue œcuménique. Puis quelques années plus tard, l’ensemble est regroupé au jeudi soir, donnant définitivement sa forme au jeudi tala, inchangé jusqu’aujourd’hui. Suite à la mort du père Portal en 1926 apparaît vraisemblablement le titre pompeux de « prince » pour désigner l’étudiant (ou les étudiants) qui organise et coordonne les activités. À partir de cette période aussi sont organisées deux « retraites » par an, l’une ayant lieu au début de l’année et l’autre pendant le Carême – les actuels « week-end de rentrée » et « week-end de Carême ». Ensuite, depuis les années 1950 au moins, l’existence de la « cave tala » est avérée, dans les sous-sols de l’ENS.
Les talas voient passer dans leurs rangs de grandes figures intellectuelles, comme le philosophe Maurice Merleau-Ponty, le spécialiste de saint Augustin Henri-Irénée Marrou, l’historien René Rémond (prince tala), etc. Un peu plus tard, ce qui se vit aux talas permet déjà durant le temps passé à l’École un engagement intellectuel. Celui-ci, en cette seconde partie du XXème siècle, se voit notamment à travers la fondation de revues qui sont alimentées par les travaux des talas : voient le jour Les Cahiers Talas à partir de 1949 devenus Le Vin Nouveau en 1955. De façon plus marquante, une branche de talas « disciples » de Mgr Maxime Charles, recteur de Montmartre, représentée principalement par Rémi Brague, Jean-Luc Marion et Jean-Robert Armogathe (tous trois de la promo 1967), fonde le pendant français de la revue catholique internationale Communio (créée en Allemagne par Urs von Balthasar un peu auparavant), à l’origine d’une école théologique féconde, avec un rôle de premier plan dans la théologie contemporaine. À la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, les talas y sont encouragés, notamment par Mgr André Brien, leur aumônier, mais aussi par Jean Daniélou (aumônier de l’École Normale de Sèvres avant de devenir cardinal) et parfois par le père Teilhard de Chardin, dont ils sont les fidèles auditeurs.
A cette époque, l’ENS n’est pas encore mixte, la branche féminine se trouvant séparée à l’ENS de Sèvres. Ce n’est qu’en 1985 que les deux écoles n’en forment plus qu’une seule mais déjà, six ans auparavant, l’aumônier, le père Guy Lafon, avait pris le parti de fusionner les deux groupes dont il était désormais responsable. La mixité tala a donc précédé celle de l’Ecole (pour une fois que les talas sont avant-gardistes...). Suite au père Lafon, premier aumônier archikhûbe – ce qui sera par la suite toujours le cas – celui qui est devenu le père Armogathe est nommé aumônier en 1979. Tout comme les « pélés talas », les jeudis talas trouvent alors leur structure canonique avec des conférences organisées par cycle et données par l’aumônier ou des intervenants extérieurs et le principat prend la forme d’une tétrarchie (avec quelques variations selon les années). Une nouvelle impulsion éditoriale est donnée avec la revue Le Serviteur inutile dont le premier numéro sort en 1981, revue qui deviendra l’actuel Sénevé en 1990. On voit l’introduction de plusieurs propositions comme les déjeuners théologiques ou des temps de prière œcuménique. Les talas mettent aussi en place progressivement des conférences adressées à tous les normaliens, parfois en lien avec d’autres associations, sur des sujets qui concernent plus largement la communauté normalienne.
Aujourd’hui, les talas se veulent être un groupe ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la foi chrétienne – que ce soit pour des raisons philosophiques, spirituelles, historiques ou esthétiques - et qui souhaitent nourrir leur réflexion à la lumière de la pensée chrétienne. Animés par le désir de participer pleinement à la vie de l’Ecole, les talas constituent aussi un lieu de convivialité et de soutien, propice au développement d’amitiés fécondes.
Plus récemment, s’est posée la question de notre place à l’ENS, notamment au regard de la laïcité qui est portée par la loi et par le règlement intérieur. Nous avons alors choisi de nous constituer en association loi 1901, pour passer du coutumier implicite à une inscription dans le cadre que l’Ecole propose, afin qu’ultimement la présence des talas à l’ENS se poursuive à travers les âges pour le bien de tous !